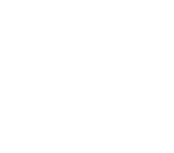Thierry Hoquet, lauréat du prix Everett Mendelsohn éclaire l’obsession de l’Angleterre victorienne pour la question du « métissage » et ses échos contemporains
« L’originalité de mon approche a consisté à faire apparaître ce qui était sous nos yeux mais que personne ne percevait clairement. En l’occurrence, j’ai mis en avant la manière dont un thème « classique » de la théorie darwinienne (les difficultés rencontrées par Darwin pour penser l’hérédité) était en réalité étroitement lié à la question de la pensée raciale et raciste. »
Avancée majeure dans la compréhension du vivant, l'ouvrage de Charles Darwin "L'Origine des espèces" a engendré des débats virulents à sa sortie en 1859. Mais quels étaient les arguments de ses détracteurs ?
L'un d'eux est « l’argument du "marin blanc" de Jenkin ». Thierry Hoquet, professeur, professeur des Universités à l'Université Paris Nanterre et directeur de l'Institut de Recherches Philosophiques (IRePh, EA373) l'a examiné en profondeur : son raisonnement, ses limites, sa réception. Ce travail fouillé a été distingué par le prix Everett Mendelsohn.
Dans cet entretien, Thierry Hoquet nous explique l'originalité de son article et les résonances de ses questions avec les évolutions de nos sociétés. Il nous laisse aussi entrevoir que la réception de ce prix révèle une forme de marginalité de la recherche francophone.

Sommaire :
|
L’équipe Point Recherche : Bonjour, merci de répondre à nos questions. L’article pour lequel vous avez été distingué traite de la réception de l’ouvrage de Charles Darwin "L'Origine des espèces". Notre époque semble marquer un retour des contestations de la théorie de l'évolution en particulier aux États-Unis. Un mouvement anti-métissage - voire carrément suprématiste - et de peur d’une supposée dilution identitaire est aussi de plus en plus assumé par certains acteurs du départ public.
Comment votre article entre-t-il en résonance avec ces actualités nationales et internationales ?
Thierry Hoquet : J’ai commencé à travailler sur cet article il y a plus de vingt ans. Ce qui m’intéressait au départ, c’était la manière dont Darwin avait théorisé la question de l’hérédité. En particulier, Darwin a ignoré les idées publiées par son contemporain Gregor Mendel, dont les travaux ont inspiré plus tard la naissance de la génétique, au début du XXe siècle.
Pour Darwin, l’hérédité est un phénomène plus « plastique », dans lequel les contributions de chacun des deux parents se mélangent. Et d’emblée, j’ai été frappé par un thème qui s’imposait dans la littérature : l’idée que le meilleur exemple pour penser cela, c’était celui du mélange racial et plus particulièrement de la couleur de peau. Lorsque deux personnes, l’une blanche, l’autre noire, font un enfant ensemble, la peau de leurs descendants n’est ni blanche ni noire, mais un mélange des deux. Cela frappait les contemporains de Darwin comme la preuve que les caractères héréditaires pouvaient être « dilués » au fil des générations.
À leurs yeux, cela constituait une objection majeure à la théorie darwinienne de la préservation des variations utiles au moyen de la sélection naturelle.
« L’originalité de mon approche a consisté à faire apparaître ce qui était sous nos yeux mais que personne ne percevait clairement. En l’occurrence, j’ai mis en avant la manière dont un thème « classique » de la théorie darwinienne (les difficultés rencontrées par Darwin pour penser l’hérédité) était en réalité étroitement lié à la question de la pensée raciale et raciste. »
| L'Origine des espèces (1859), un ouvrage fondateur La théorie de Darwin a pour fonction d’expliquer l’évolution des espèces au fil du temps. Pour Darwin, les espèces n’existent pas d’emblée, toutes créées en même temps. Elles apparaissent successivement, les unes à partir des autres : il y a donc une généalogie des espèces, un engendrement progressif, génération après génération. L’histoire du vivant est donc travaillée par des processus qui transforment graduellement les espèces, et font apparaître de nouvelles formes de vie, occupant des niches écologiques variées. Pour expliquer cela, Darwin est le premier à proposer un mécanisme. Ce processus est d’une grande complexité et Darwin le nomme, faute de mieux, la « sélection naturelle ». Ce mécanisme conjugue des données biologiques (il existe dans chaque espèce un grand nombre de variations et il n’y a quasiment jamais deux individus parfaitement identiques) et des données environnementales (le vivant se multiplie à une allure si rapide que les ressources finissent nécessairement par manquer). Cela implique l’élimination d’une partie des descendants (tous ne peuvent pas survivre) et ce « crible » opère progressivement la transformation des formes vivantes et l’apparition de nouvelles espèces. Ainsi, par des processus destructeurs, la sélection naturelle s’avère paradoxalement créatrice de beauté et de diversité. Lire → l'article Wikipédia de l'ouvrage |
Thierry Hoquet : L’originalité de mon approche a consisté à faire apparaître ce qui était sous nos yeux mais que personne ne percevait clairement. En l’occurrence, j’ai mis en avant la manière dont un thème « classique » de la théorie darwinienne (les difficultés rencontrées par Darwin pour penser l’hérédité) était en réalité étroitement lié à la question de la pensée raciale et raciste. J’ai mis en évidence l’existence d’un motif obsessionnel dans la littérature de l’époque : celui du marin blanc échoué sur une île peuplée de Noirs.
Pour les contemporains de Darwin, ce marin blanc était doté d’une claire « supériorité » sur le reste de la population, mais sa différence se trouvait progressivement « submergée » par la couleur noire, au fil des générations. Ce motif exprime le fantasme d’une pensée suprématiste blanche, et l’angoisse de sa dilution ou de sa submersion, par une population noire jugée « inférieure » mais en quantité plus nombreuse.
Ce thème racial est extrêmement prégnant dans la théorie de l’hérédité mais il était rarement explicité comme tel.
| Qu'est-ce que l’argument du « marin blanc » de Jenkin ? L’exemple du « marin blanc » isolé et progressivement submergé par une population noire plus nombreuse met clairement en évidence l’obsession de l’Angleterre victorienne pour la question du « métissage ». La question que se pose Darwin est de savoir si lorsque des individus très différents se croisent, cela produit davantage de variation ou si au contraire les variations existantes se trouvent diluées. La génétique de la couleur de la peau était fort mal connue à l’époque, ce qui posait d’importantes questions concernant l’origine des races humaines. Pour Darwin, l’origine des races humaines est liée à des préférences esthétiques. C’est la manière dont les femmes et les hommes choisissent leurs partenaires sexuels qui détermine l’apparition ou la disparition de certains caractères physiques comme les poils ou la morphologie. Lire → l'article complet de Thierry Hoquet dans le Journal of the History of Biology |
L’équipe Point Recherche : Bien que non ébranlé dans ses conclusions, on voit que Darwin a pris acte des objections à travers les modifications opérées dans la cinquième édition de l'Origine des espèces de 1869. Quelles sont-elles ?
Thierry Hoquet : En vérité, Darwin a travaillé activement à établir sa propre théorie de l'hérédité (la pangenèse, qu'il publie en 1868), et c'est aussi pour cela qu’il a abondamment modifié son texte à partir de 1869. Le sujet de l’hérédité était encore plongé dans l’obscurité pour lui, et il en discutait souvent avec son cousin, Francis Galton, qui allait inventer le mot « eugénisme ».
Face aux critiques concernant une potentielle « submersion » des variations avantageuses, Darwin a avancé l’idée qu’une même variation pouvait apparaître simultanément un grand nombre de fois dans une population. Cela permettait de déplacer la focale, et de dégonfler le rôle central du « marin blanc », l’idée d’un mutant unique doté d’une caractéristique exceptionnelle. Tout est différent dès lors que cette caractéristique utile est possédée par plusieurs individus à la fois.
Ces objections ont donné lieu une nouvelle question : d’où viennent les variations ?
« Je vais peut-être vous surprendre mais il est clair selon moi que la France et ses chercheurs appartiennent aux périphéries de l’Empire anglophone : nous sommes des marginaux, ou si vous voulez, des « outsiders ».
[…] Il ne s’agit pas seulement pour nous de « traduire » nos pensées, ce qui serait encore réalisable ; mais il s’agit de les adapter à un contexte anglophone « global » dans lequel nous n’avons pas toujours toutes les clefs culturelles et pas non plus les réseaux ou les relais nécessaires. »
Thierry Hoquet
L’équipe Point Recherche : Que représente pour vous le prix Everett Mendelsohn ? Quel est son statut dans la communauté académique ?
Thierry Hoquet : Comme je l’ai dit, j’ai travaillé près de vingt ans sur cet article et j’ai dû le soumettre à plusieurs reprises avant de le voir publié. J’ai subi au cours de ce long processus des rafales de critiques humiliantes : allant du fait que je n’étais manifestement pas « natif » de la langue anglaise, au fait que je traitais des questions très techniques mais qui n’intéressaient plus personne, ou bien que mon travail était de qualité mais qu’il vaudrait mieux que j’écrive un tout autre article en procédant d’une manière totalement différente.
Ces difficultés ou ces obstacles ne sont pas seulement dus à la qualité de l’argument que je présentais ou à la qualité de mon expression. La situation est plus générale. Je vais peut-être vous surprendre mais il est clair selon moi que la France et ses chercheurs appartiennent aux périphéries de l’Empire anglophone : nous sommes des marginaux, ou si vous voulez, des « outsiders ». C’est particulièrement net dans ce qui relève des sciences humaines : du fait de la finesse requise pour l’expression de nos pensées, mais aussi du fait de la différence des styles de raisonnement, la question de la langue devient un véritable handicap pour les chercheurs francophones. Il ne s’agit pas seulement pour nous de « traduire » nos pensées, ce qui serait encore réalisable ; mais il s’agit de les adapter à un contexte anglophone « global » dans lequel nous n’avons pas toujours toutes les clefs culturelles et pas non plus les réseaux ou les relais nécessaires. Bref, nous vivons aux marges, et cela n’est pas seulement de notre faute : la langue française est de moins en moins pratiquée par nos collègues étrangers, également happés par ce mouvement « global » qui polarise toutes les cultures vers l’hégémonie unique de l’anglais. Ce point n’est pas seulement linguistique : il est aussi institutionnel et culturel.
Tout cela vous explique à quel point le fait que j’obtienne ce prix est important. Pour vous faire rire, je dirais que c’est un prix qui normalement consacre les travaux de jeunes chercheurs anglophones, disons des « post-docs ». Le fait que je l’obtienne alors que je suis un chercheur « confirmé » est une reconnaissance à la fois de la qualité de mon travail et la parfaite illustration des difficultés que j’exprime. Je dois ce prix d’une part à mes efforts acharnés, mais d’autre part à l’engagement sans faille de plusieurs éditeurs du Journal of the History of Biology qui ont soutenu mon travail et m’ont aidé à le porter devant la communauté internationale.
L’équipe Point Recherche : Quels sont vos domaines de recherche ? Qu’est-ce qui vous a donné envie de vous y intéresser ? Vers où comptez-vous continuer à creuser ?
Thierry Hoquet : J’ai été formé dans l’histoire de la philosophie, avec un intérêt pour les théorisations biologiques et leur histoire. J’ai longtemps travaillé dans un style proprement français, ce qu’on appelle « l’épistémologie historique ».
Peu à peu, les problématiques « sociétales » ont pris de plus en plus de place dans mes recherches. Dès 2007, j’ai commencé à travailler sur les questions de sexe et de race, en collaboration avec Elsa Dorlin avec laquelle j’ai porté le projet ANR « BIOSEX : le sexe à l’épreuve des sciences biomédicales ». Plusieurs publications sont issues de ces travaux, notamment une vaste anthologie intitulée « Le sexe biologique : anthologie historique et critique », parue chez Hermann en trois volumes (2013-2017).
| Pour aller plus loin… Consulter → la page de Thierry Hoquet sur le site de l'IRePh Consulter → l'annonce de la réception du prix Lire → l'article complet de Thierry Hoquet dans le Journal of the History of Biology |
Au cours de ces années, j’ai enseigné l’épistémologie féministe, les concepts liés à la différence des sexes et l’histoire du concept de race. Aujourd’hui, je viens de publier une « Histoire (dé)coloniale de la philosophie française » (PUF, 2025).
« Je pense qu’il est essentiel dans le contexte actuel de développer une pensée critique, à l’heure où partout dans le monde, des politiques contestent la liberté académique en l’étiquetant du nouveau terme infamant de "wokisme". »
Thierry Hoquet
Je pense qu’il est essentiel dans le contexte actuel de développer une pensée critique, à l’heure où partout dans le monde, des politiques contestent la liberté académique en l’étiquetant du nouveau terme infamant de « wokisme ». Là où les conservateurs hurlent contre « l’obscurantisme woke », il est important de se rappeler l’importance des « lumières woke », selon la formule de mon ancien doctorant Pierre Niedergang.
| ► Tous les portraits de chercheuses et chercheurs de l'Université Paris Nanterre |
Mis à jour le 15 mai 2025