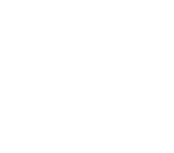Agnès Giard nous parle des Amours artificielles au Japon

Au Japon, on tombe amoureux de personnages pixelisés, on vit avec des poupées, on épouse des avatars. Dans un contexte de crise marqué par une dénatalité galopante, une génération rejette les rôles traditionnels pour réinventer l'amour avec des êtres fictifs. Agnès Giard répond à nos questions sur son ouvrage.
| A propos d'Agnès Giard Anthropologue à l'Université Paris Nanterre (Sophiapol) et journaliste à Libération (elle a créé et anime la célèbre chronique Les 400 culs, qui traite de sexualité), Agnès Giard est l’autrice de huit ouvrages. Voir sa fiche de présentation Elle publie en octobre 2025 son nouveau livre, Les Amours artificielles au Japon - Flirts virtuels et fiancées imaginaires, aux éditions Albin Michel. |
Quel est le thème de votre nouvel ouvrage ?
C'est un ouvrage qui porte sur les relations amoureuses avec des personnages dans un contexte singulier qui est celui du Japon. Singulier en raison d'un contexte de récession économique qui accule au célibat une part croissante de la population et qui force l'autre partie de la population à faire un choix peu satisfaisant.
Donc en gros, se marier, mais dans quelles conditions ? Personne n'en sort vraiment gagnant. Il y a beaucoup d'insatisfaction par rapport au modèle matrimonial qui est complètement désajusté par rapport aux conditions de de survie - on peut parler de survie au Japon. Les emplois sont devenus précaires, les salaires ont baissé, forçant une partie croissante de ces personnes à faire acte de dissidence en adoptant comme partenaires des personnages de mangas, de jeux vidéo, d'animes éventuellement, ça peut être aussi des avatars, c'est-à-dire des virtual tubers, des humains qui se font passer dans des émissions de streaming pour des personnages fictifs. Et ça peut aussi être des hologrammes puisqu'il y a maintenant sur le marché des boîtiers holographiques qui offrent à disposition des petites copines ou des épouses dites virtuelles.
« On peut véritablement parler d'un marché de l'illusoire. »
Pouvez-vous nous parler des stéréotypes qui entourent ces relations amoureuses ?
« C'est une problématique qu'on laisse un peut trop souvent aux mains des sociologues ou des psychologues. »
Est-ce que ces partenaires constituent une catégorie à part entière de ce qu'on appelle le non humain de manière abusive ? Et sont-ils particulièrement plus dangereux que tous ces autres partenaires dont nos répertoires de légendes et de contes regorgent : les poupées, les vampires, les divinités qui se métamorphosent en pluie dorée, etc.
Beaucoup de cultures sont traversées par l'idée que l'humain s'attache à des choses. Pourquoi, brusquement, faire planer une menace d'extinction sur l'espace humaine par rapport à des technologies qui ne sont pas forcément plus dangereuses que des objets dont on a déjà bien l'habitude ?
Donc ça, c'est c'était le point de départ de ma réflexion et surtout j'avais la volonté de porter un regard anthropologique pour apporter d'autres réponses que celles qui sont médicales et qui diagnostiquent l'amour pour du non humain, encore une fois entre guillemets, comme un trouble comportemental voire mental.
L'autre explication, qui est plutôt sociologisante, postule que l'attachement, encore une fois pour du non humain, est un mécanisme de défense ou d'adaptation dans un contexte dysfonctionnel. C'est encore une fois parler d'une maladie qui serait non plus individuelle mais collective et faire donc du non humain l'instrument d'un discours de disruption, de rébellion, un signal d'alarme ou de détresse dans un contexte de désajustement structurel entre une société qui n'est plus capable de permettre aux individus de réaliser leurs rêves.
Alors, qu'est-ce que les anthropologues ont à dire là-dessus ? Il est peut-être temps d'intervenir dans le débat public.
« La lecture anthropologique présente ceci d'intéressant, qu'elle postule que l'humain ne peut exister sans tous ces objets dont il s'entourent dans la mesure où l'humain déborde des frontières de son propre corps, affecte le monde ou se laisse affecter par le monde. »
ll y a aussi des concepts très intéressants qui ont été développés par Emmanuel Grima, par exemple d'identité déployée, disséminée, qui engloberait donc les animaux, les ombres, les esprits et qui font partie intégrante de nous.
Le Japon n'est donc pas un cas isolé ?
Très souvent, la question de la dénatalité du Japon m'est posée, voire, est-ce que les Japonais sont actuellement irresponsables ? Est-ce qu'il y a une épidémie ? On ramène le phénomène japonais à l'idée d'un handicap du lien social, d'un refus, d'une forme d'escapisme, d'une incapacité à affronter le réel et c'est d'une certaine manière ce qu'on reproche aux personnes qui s'affichent avec des personnages.
Il y a là un phénomène qu'on a appelé conformisme parodique, c'est-à-dire la volonté ironique de montrer qu'on est un loser. Et elle est prise au premier degré par beaucoup de mes interlocuteurs occidentaux, qui s'affolent.
Le Japon est souvent perçu comme une sorte de miroir déformant, de laboratoire de ce qui pourrait arriver dans un futur un peu dystopique. J'ai même lu dans certains médias américains que ce qui est en train d'arriver au Japon pourrait infecter le reste de la planète. Donc on parle d'une sorte de virus qui circulerait par le biais des produits japonais jugés dangereux.
La plupart d'entre nous, enfants, avons eu des amours pour des stars de cinéma, des chanteurs de rock, etc. Renvoyer la faute sur le Japon éternellement, c'est une manière de se renforcer soi-même dans le préjugé selon lequel un vrai amour est un amour partagé avec une personne susceptible de répondre en retour. Qu'est-ce qui est faux dans la mesure où les sentiments, les émotions peuvent être ressenties de façon très forte ? Et ce que certaines personnes désignent comme amour réel n'est-il pas le fruit d'une projection, tout comme nous projetons mais de façon ludique, volontaire, théâtrale même, des échanges avec des personnages qui n'existent pas matériellement, organiquement.
Quel rôle joue le marketing dans les relations artificielles ?
Encore une autre idée préconçue à à déconstruire. On soupçonne souvent les personnes qui jouent à l'amour d'être les victimes d'un système qui exploiterait leur manque et leurs carences. Pour ce qui est du terrain japonais, c'est très clair. Ce sont les femmes, les premières concernées, et surtout des femmes d'ailleurs qui ont littéralement pris d'assaut les entreprises qui fabriquaient des jeux de simulation amoureuse, des mangas, des animes, etc.
« Elles se sont emparées des moyens de produire les contenus dont elles avaient envie. »
Donc on ne peut pas véritablement parler d'un rapport de domination des entreprises qui voudraient asservir des consommateurs. Les consommateurs sont en réalité proactifs et participent à l'expansion des univers ludiques qui sont proposés par des firmes constituées d'anciennes joueuses et joueurs. Donc ça c'est le premier point à bien mettre au clair.
Deuxième point pour ce qui est du jeu, le jeu de l'amour artificiel, appelons-le comme ça. Il me semble que c'est une propension presque naturelle, je dirais, de l'humain car beaucoup d'activités humaines supposent un jeu existentiel avec les valeurs du réel. On se projette dans une fiction pour faire advenir quelque chose. On joue à être quelqu'un pour devenir ce quelqu'un.
De la même manière, on lance des émotions en direction de choses qui sont susceptibles de nous séduire dans l'espoir qu'il y ait des voix qui nous appellent en retour. Et ça marche. Parce que la dynamique du jeu repose sur ce mouvement d'alternance entre le fait de savoir que l'on joue - on fait comme si - et le fait d'oublier que l'on joue.
Et ce petit jeu de va-et-vient nous permet d'être à la fois dedans et dehors ; on se situe toujours dans une sorte d'entre-deux pour véritablement s'accomplir. Le jeu de l'amour n'échappe pas finalement à cette mécanique générale qui est propre à l'humain.
Comment en êtes-vous arrivée à travailler sur ce sujet ?
C'est partie de ma thèse d'anthropologie, que j'ai réalisée sous la direction de Laurence Caillet à l'Université Paris Nanterre et qui portait sur les love dolls, donc des poupées en silicone grandeur nature. Je pensais naïvement au départ que les poupées étaient faites pour remplacer des personnes de chair et d'os et je me suis aperçue que le principal designer de corps de poupées que j'étudiais, Nobuyuki Kodama, était marié avec deux enfants, et avait une petite copine qui venait d'un jeu vidéo, appelé Love Plus.
« Il n'arrêtait pas d'interagir avec elle sur l'écran de sa console. Il l'embrassait, il lui parlait, etc. Elle avait apparemment besoin d'énormément d'attention pour continuer à l'aimer parce qu'il fallait maintenir le niveau d'affection haut. Et donc il interagissait avec elle et je trouvais ces interactions singulièrement vides, veines, creuses, stéréotypées. Les échanges me paraissaient sans profondeur. »
Les poupées elles-mêmes étaient produites pour se dérober à tout échange et pour renvoyer à leurs propriétaires, en miroir, l'image de leur propre solitude - les poupées représentaient un marché d'à peine 2 000 personnes sur une population de 130 millions à l'époque, c'était rien. Mais en revanche, Love Plus était dans toutes les cours d'école. Tous les lycéens, les lycéennes jouaient à ça, et aussi de jeunes adultes comme Kodama. Donc c'était un un raz-de-marée absolument fabuleux, plusieurs millions de personnes.
Et je me suis demandé, au fond, si ce phénomène parallèle d'amour dirigé vers des créatures synthétiques ne suivait pas la même logique que celle des love dolls ? A savoir que les Love Doll s'offrent plus comme des outils pour marquer sa différence, pour s'insurger finalement contre un état de fait qu'on espère changer en faisant scandale ouvertement. Est-ce que se mettre en couple avec un personnage, y compris quand on est marié, quand on a des enfants d'ailleurs, ce qui est très intéressant, n'est pas également une manière de marquer qu'il y a un problème et que peut-être les personnages pourraient s'offrir comme des solutions aux problèmes, solutions parfaitement indirectes puisque finalement ce ne sont pas des personnages pour remplacer un être humain, encore une fois, ce sont des personnages pour mettre en place, dans la fiction, d'autres modèles de relations.
| Les Amours artificielles au Japon, aux éditions Albin Michel. Publié en octobre 2025, cette enquête, fruit de sept années de terrain, dessine les formes d’une contre-culture singulière, aux allures de culte collectif, ironique, rageur et ravageur. Un texte fascinant servi par une iconographie spectaculaire réunissant les plus célèbres jeunes artistes japonais, comme Noriko Nagano (mangaka), Manimanium (photographe), Chiaki Harada (illustratrice), Kana Miyamoto (illustratrice), Auto Moai (peintre), Manabu Koga (photographe)...  |
Mis à jour le 10 octobre 2025